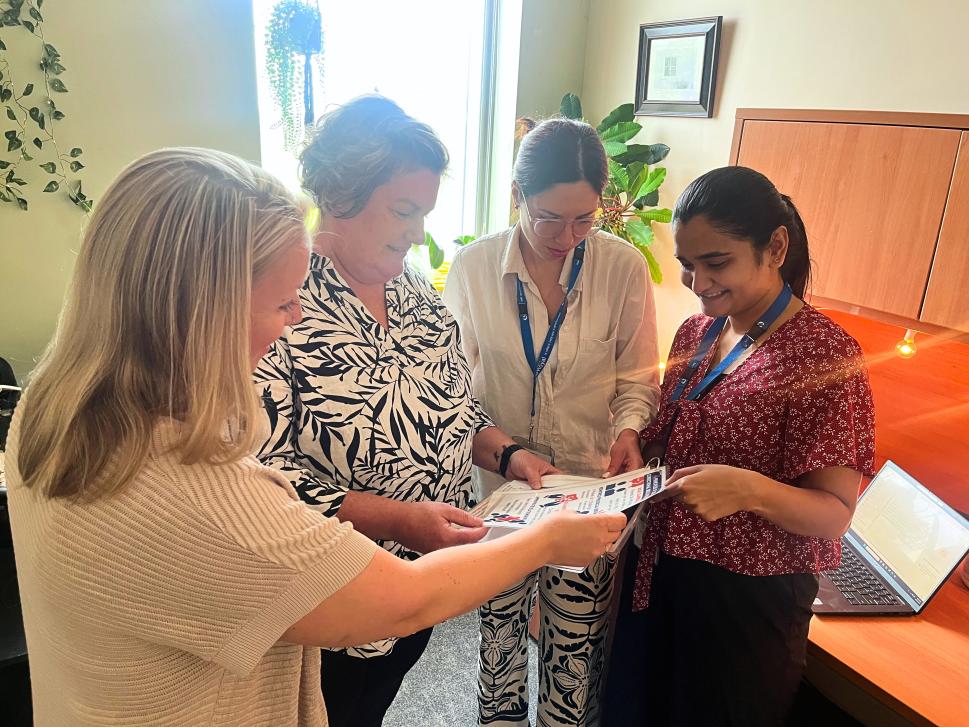Dans les milieux correctionnels et de psychiatrie légale, le personnel joue un double rôle : établir une relation thérapeutique tout en faisant respecter les règles auprès des patients en placement non volontaire afin d’assurer la sécurité. C’est un travail exigeant, où les enjeux sont élevés et les risques réels, tant pour les patients que pour les membres du personnel.
Pour mieux soutenir les équipes et améliorer les résultats cliniques, le Royal a introduit un modèle prosocial dans son Unité de traitement en milieu fermé, en commençant par son campus de Brockville.
Le modèle prosocial est une approche structurée et fondée sur des données probantes, conçue pour accompagner les équipes travaillant avec les patients en placement non volontaire – des personnes qui ont besoin de soins en santé mentale, mais qui ne les demanderaient pas spontanément.
Ce modèle repose sur des principes comportementaux éprouvés et a déjà été mis en œuvre avec succès dans des milieux correctionnels ou de traitement en milieu fermé au Canada, aux États-Unis et en Australie.
Au cœur de ce modèle se trouvent quatre compétences clés : la clarification des rôles, l’établissement de relations, le renforcement positif et la résolution efficace des problèmes.
« Le modèle prosocial ne fait pas disparaître le stress ou les conflits, mais il offre un excellent cadre pour y répondre », explique la Dre Anik Gosselin, psychologue au campus de Brockville et superviseure clinique du Programme de psychiatrie légale intégrée.
« L’objectif est d’aider les patients à développer des comportements et attitudes prosociaux, à réduire les attitudes antisociales, ainsi qu’à améliorer la satisfaction du personnel et le climat social dans les milieux correctionnels et de psychiatrie légale, afin de favoriser un environnement général plus respectueux pour tout le monde. »
Les quatre principes du modèle prosocial
Le premier principe, la clarification des rôles, aide les membres du personnel à expliquer leurs responsabilités aux personnes qu’ils soignent dans un langage simple et cohérent. Cela comprend la clarification des limites, des règles et des options (ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas). Ce principe permet aussi d’aborder la réalité complexe des rôles doubles. Le personnel doit parfois passer rapidement d’un rôle à un autre.
« C’est un équilibre difficile à maintenir », indique Mme Gosselin. « Une minute, vous cherchez à faire respecter les règles ; et la suivante, vous offrez un soutien thérapeutique. C’est probablement l’un des plus grands défis pour les équipes qui travaillent auprès de cette population. Ce modèle leur donne une manière d’assumer ces deux rôles sans compromettre la relation thérapeutique. »
Le deuxième principe, le renforcement positif, encourage le personnel à modéliser, identifier et valoriser les comportements prosociaux au moment où ils se produisent, et à aborder les comportements antisociaux de manière non culpabilisante. Dans les milieux à risque élevé, il est courant que le personnel se concentre uniquement sur les comportements problématiques pour assurer la sécurité de l’environnement. Ce modèle propose un changement de perspective : mettre l’accent sur le renforcement des comportements prosociaux plutôt que de réagir uniquement aux comportements problématiques, ce qui augmente leur probabilité que ces comportements se manifestent de nouveau.
Le troisième principe, la résolution de problèmes, aide le personnel à répondre plus efficacement aux plaintes et aux difficultés des patients, en les accompagnant dans la recherche de leurs propres solutions plutôt qu’en leur disant quoi faire. Le personnel utilise des techniques simples et structurées pour aider les patients à réfléchir aux conséquences de leurs choix et à envisager d’autres réponses possibles.
« Les patients qui ont eu des démêlés avec la justice ont souvent beaucoup de mal à régler les problèmes », explique Mme Gosselin. « Bon nombre d’entre eux luttent contre des dépendances ou ont un lourd passé de traumatismes, et lorsqu’ils sont dépassés, même les mieux intentionnés peuvent prendre des décisions qui les replongent dans les ennuis », poursuit-elle.
« Par exemple, au lieu de résoudre un conflit familial, certains vont complètement couper les ponts pendant des mois. D’autres vont consommer des substances pour faire face au stress de payer leur loyer, au lieu de chercher des solutions plus créatives et efficaces. Nous leur apprenons à voir leurs problèmes autrement et à essayer de nouvelles façons de les résoudre. »
Le quatrième principe, l’établissement de relations, repose sur les liens de confiance. Les personnes prises en charge dans les milieux correctionnels ou de psychiatrie légale ont souvent un passé marqué par les traumatismes et des relations compliquées avec les institutions ou les figures d’autorité. La formation met l’accent sur une communication chaleureuse, ouverte, non culpabilisante, avec une approche à la fois ferme et équitable.
De la théorie à la pratique
Faute de pouvoir former tout le personnel par des formateurs externes, un modèle de « formation des formateurs » a été mis en place. Sept membres de l’équipe ont été formés par la Dre Philippa Evans et le Dr Chris Trotter, les professeurs qui ont conçu le modèle.
La formation du personnel du Royal a débuté au printemps 2024 et les retours sont extrêmement positifs.
Ayant conscience que la formation à elle seule ne suffit pas à modifier les pratiques professionnelles, un groupe de formateurs internes et de « champions » au sein des unités assure un accompagnement continu et du mentorat. L’équipe de formateurs a également prévu un soutien supplémentaire pour la mise en œuvre. Le personnel a accès à des rappels visuels et à des guides de discussion afin de renforcer l’application concrète du modèle prosocial.
« Il est difficile de changer ses habitudes, surtout dans un environnement sous pression, mais notre équipe croit sincèrement à cette approche », affirme Mme Gosselin. « Le modèle prosocial relève presque du bon sens, il est intuitif. C’est la façon de l’appliquer auprès de cette population qui le rend unique. »
L’évaluation est un élément clé du processus : elle permettra de mesurer les effets sur le climat des unités, la satisfaction du personnel et l’expérience des patients dans les milieux correctionnels et de psychiatrie légale. Les premières évaluations indiquent qu’après leur formation, les membres du personnel se sentent plus confiants et mieux préparés à gérer les situations difficiles.
« Le modèle prosocial aide le personnel à établir des relations thérapeutiques plus solides et à gérer les comportements complexes avec respect », explique Kristina McGeough, directrice exécutive et responsable du site du campus du Royal à Brockville. « Il renforce la sécurité, la qualité des soins et la confiance du personnel. C’est un modèle durable, fondé sur la recherche, et qui reflète notre engagement à obtenir de meilleurs résultats tant pour les patients que pour le personnel. »
Le modèle prosocial sera progressivement mis en œuvre dans tous les programmes de psychiatrie légale du Royal, à Brockville et à Ottawa. Mme Gosselin estime que même si ce modèle a été conçu pour les milieux correctionnels et de psychiatrie légale, ses principes peuvent s’appliquer dans bien d’autres contextes.
« Le principe de base est d’améliorer les comportements en utilisant les interventions les plus efficaces, mais aussi de favoriser la dignité, le respect et la sécurité », ajoute Mme Gosselin. « N’importe quel milieu qui accueille des patients en placement non volontaire et où le personnel doit établir des relations thérapeutiques tout en faisant respecter les règles, pourrait bénéficier de cette approche. »
Alors que le Royal continue d’investir dans des soins fondés sur la recherche et centrés sur les personnes, le modèle prosocial permet de concrétiser ces valeurs au quotidien – en soutenant les patients, en donnant des moyens d’action au personnel et en créant des environnements plus sûrs et plus respectueux pour toutes et tous.