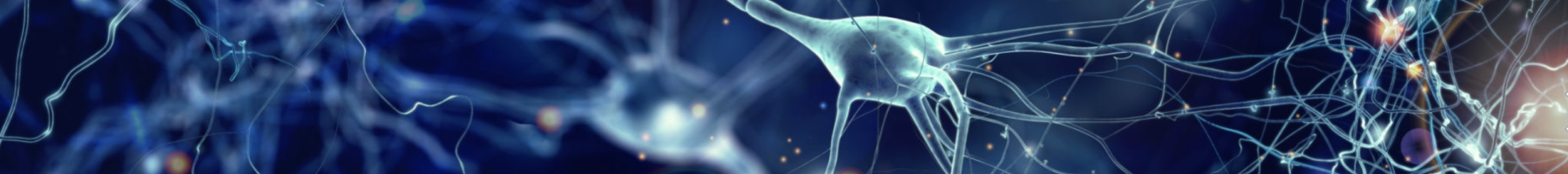Le Fonds de recherche médicale universitaire (UMRF, University Medical Research Fund) a financé six projets innovants qui permettront de faire progresser la compréhension de la schizophrénie, de l’insomnie, des infractions sexuelles et des expériences des peuples autochtones au sein du système de justice pénale. Ces études visent à améliorer les diagnostics, les traitements et la prévention, tout en rendant les soins plus sûrs, plus personnalisés et plus accessibles.Félicitations à tous les lauréats de cette année!
Le concours de subventions du Fonds de recherche médicale universitaire (FRMU) est rendu possible grâce aux contributions des Associés en psychiatrie du Royal. Il a été établi pour encourager des études de pointe multidisciplinaires et interdisciplinaires au Royal qui intègrent étroitement la recherche et les soins dans le but d’améliorer les soins, l’accès, la qualité et la sécurité.
Grâce aux subventions du FRMU, les équipes à l’origine de ces projets de recherche avant-gardistes menées au Royal recevront un soutien financier pour lancer des études de pointe en vue d’améliorer les soins et d’aider les personnes atteintes de maladie mentale à se rétablir plus rapidement.
« Des équipes qui réunissent des expertises, des idées et des perspectives variées se mettent au défi de mener des recherches novatrices qui apportent à la fois de l’espoir et des soins aux personnes atteintes de maladie mentale », déclare le Dre Florence Dzierszinski, présidente de l’Institut de recherche en santé mentale de l’Université d’Ottawa au Royal. « Le concours de subventions du FRMU a permis de mener des recherches novatrices au Royal qui changent des vies, et nous souhaitons remercier les Associés pour leurs contributions continues au financement de ce programme. »
Récipiendaires des subventions de 2025 de l’UMRF :
Examiner les phénotypes multidimensionnels de l’insomnie et leur valeur prédictive pour la réponse au traitement : étude observationnelle en conditions naturelles
Équipe de recherche : Soojin Chun (chercheuse principale), Rebecca Robillard, Elliot Lee, Lisa Kis, Sophiya Benjamin, Michael Samson, Andrée-Ann Baril, Alan Douglass, Colleen Carney, Anik Gosselin, Caitlin Higginson et Jaqueline Fournier
Financement : 100 000 $ ; 2 ans
L’insomnie est l’un des troubles du sommeil les plus courants, mais la majorité des recherches menées jusqu’à présent portent sur des groupes restreints qui ne reflètent pas toute la diversité des expériences vécues. Les approches actuelles classent souvent les personnes insomniaques selon qu’elles dorment plus de six heures ou moins de six heures par nuit, un système limité qui néglige des facteurs essentiels tels que la qualité du sommeil, l’activité cérébrale et le stress de ces personnes.
Dans cette étude, les chercheurs utiliseront des dispositifs portables de suivi du sommeil et du rythme cardiaque, en parallèle de la thérapie offerte à la nouvelle Clinique de l’insomnie du Royal, afin d’établir des « profils » d’insomnie plus précis. En reliant ces profils à la réponse au traitement, les chercheurs visent à personnaliser les soins, à améliorer les résultats de la thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie (TCC-I) et à réduire les plus vastes répercussions mentales et physiques du manque de sommeil.
La polypharmacie chez les patients atteints de schizophrénie dans les milieux de psychiatrie légale et générale : une analyse comparative de la résistance au traitement et de l’utilisation de la clozapine
Équipe de recherche : Amanjot Sandhu (chercheuse principale), John Bradford, Sanjiv Gulati, Gary Chaimowitz, Andrew Olagunju, Mark Kaggwa, Precious Agboinghale et Sydney Graham
Financement : 96 640 $ ; 2 ans
La schizophrénie est une maladie mentale chronique habituellement traitée à l’aide d’un seul antipsychotique. Cependant, dans de nombreux cas, en particulier lorsque les symptômes ne s’améliorent pas, plusieurs antipsychotiques sont prescrits simultanément, une pratique appelée « polypharmacie ». Bien que parfois nécessaire, la polypharmacie est associée à des effets indésirables graves, notamment la prise de poids, des troubles métaboliques et des atteintes cognitives. Ce problème est particulièrement préoccupant dans les milieux de psychiatrie légale, où la schizophrénie réfractaire aux traitements est plus fréquente et où les taux de polypharmacie sont nettement plus élevés que dans les milieux de psychiatrie générale.
Cette étude vise à comparer les taux de résistance au traitement et de polypharmacie chez les patients atteints de schizophrénie suivis en psychiatrie légale et en psychiatrie générale au Royal, au Centre de santé mentale de Brockville et à l’Hôpital St. Joseph’s Healthcare à Hamilton. En examinant les ordonnances de ces patients et les facteurs qui y sont associés, les chercheurs essaieront de déterminer si la polypharmacie est utilisée de manière appropriée ou excessive dans les milieux de psychiatrie légale. Les résultats pourraient orienter des pratiques de traitement plus éthiques et plus efficaces, améliorer les soins offerts à une population fortement stigmatisée et jeter les bases d’études plus vastes à l’échelle de l’Ontario.
Évaluation du dysfonctionnement glutamatergique chez les patients atteints de schizophrénie au moyen de TEP et d’IRM
Équipe de recherche : TiChen Hsieh (chercheur principal), Reggie Taylor, Hussein Bdair, Lauri Tuominen et Synthia Guimond
Financement : 96 996 $ ; 2 ans
La schizophrénie touche environ 1% de la population et coûte près de 10 milliards de dollars par an au Canada. Si les traitements actuels sont efficaces contre les symptômes positifs tels que les hallucinations et les idées délirantes, ils ont peu d’effet sur les symptômes négatifs et cognitifs, comme le manque de motivation ou les troubles de la mémoire, qui sont plus difficiles à traiter et ont une plus grande incidence sur la qualité de vie à long terme. Selon une hypothèse, ces symptômes seraient liés à un déséquilibre entre les activités cérébrales excitatrice et inhibitrice, mesurables à travers des neurotransmetteurs comme le glutamate et le GABA.
Cette étude fera appel aux techniques d’imagerie cérébrale de pointe du Royal pour mesurer cet équilibre entre les activités excitatrice et inhibitrice dans le cerveau des personnes atteintes de schizophrénie et chez des témoins en bonne santé. En combinant les données des examens TEP et IRM avec des évaluations cognitives et symptomatiques, les chercheurs essaieront de comprendre comment les variations de la chimie cérébrale et de l’activité des récepteurs sont liées aux symptômes négatifs et cognitifs. Les résultats pourraient mener à la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques, à de meilleurs diagnostics et à des options plus efficaces pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec la schizophrénie.
Infractions sexuelles commises sur des mineurs : auteurs et victimes au Canada
Équipe de recherche : Jonathan Gray (chercheur principal), Michael Seto, Kailey Roche et Madison McAskill
Financement : 89 501 $ ; 2 ans
Les infractions sexuelles commises sur des mineurs concernent les relations sexuelles entre des adultes et des adolescents de 13 à 15 ans, soit en deçà de l’âge légal du consentement au Canada. Contrairement à d’autres formes de violence sexuelle envers les enfants, ces relations sont souvent continues et parfois initiées par l’adolescent, ce qui les rend mal comprises et rarement signalées. Bien que la recherche ait démontré que ces relations peuvent nuire aux adolescents, la plupart des études portent uniquement sur les cas signalés à la police, laissant d’importantes lacunes dans la compréhension des adultes concernés, des adolescents concernés et du rôle des technologies en ligne.
Ce projet vise à combler ces lacunes au moyen de trois études : un examen des dossiers d’adultes suivis à la Clinique sur les comportements sexuels au Royal, une enquête nationale auprès d’adultes ayant possiblement eu de telles relations, et une enquête auprès de jeunes adultes ayant vécu ces relations à l’adolescence. Ces trois études permettront conjointement de mieux comprendre à la fois les auteurs et les victimes, de cerner les besoins en matière de traitement et de prévention, et d’éclairer les programmes d’éducation destinés aux familles, aux écoles et aux communautés afin de mieux protéger les adolescents.
Perceptions des délinquants autochtones à l’égard de la Commission ontarienne d’examen
Équipe de recherche : Floyd Wood (chercheur principal), Amy Bombay, Gary Chaimowitz, Treena Wilkie et Maryana Kravtsenyuk
Financement : 84 124 $; 2 ans
Les peuples autochtones sont surreprésentés dans le système de justice pénale canadien, mais on connaît encore peu leurs expériences au sein de la Commission ontarienne d’examen (COE), qui supervise les personnes déclarées non criminellement responsables ou inaptes à subir un procès. Selon les principes énoncés dans l’arrêt Gladue, les tribunaux doivent tenir compte des circonstances particulières des délinquants autochtones. Cependant, nous ne savons pas dans quelle mesure ces principes sont appliqués de façon cohérente dans le cadre des procédures de la COE. Les premières recherches laissent entendre que les personnes autochtones pourraient passer plus de temps sous la supervision de la COE, même lorsqu’elles présentent un faible risque de récidive si elles bénéficient de programmes adaptés à leur culture, ce qui souligne la nécessité d’un examen approfondi.
Ce projet opportun consistera à examiner des dossiers, à mener des entretiens et des cercles de partage, ainsi qu’à recueillir des données dans le cadre de sondages menés auprès de personnes autochtones actuellement ou anciennement sous la supervision de la COE dans trois établissements ontariens. L’objectif est d’évaluer leurs perceptions en matière de sécurité culturelle, de cerner les lacunes dans les soins tenant compte des traumatismes et des réalités culturelles, ainsi que de recueillir des recommandations de changement. Les résultats permettront d’éclairer la mise en œuvre d’interventions mieux adaptées à la culture, d’orienter les pratiques de la COE et de soutenir les efforts visant à remédier aux inégalités systémiques auxquelles sont confrontés les délinquants autochtones.
Le méthylphénidate à libération prolongée comme traitement d’appoint pour les patients atteints de schizophrénie : essai croisé et ouvert, à posologie fixe, mené dans un seul centre pour améliorer les résultats fonctionnels et cognitifs
Équipe de recherche : Naista Zhand (chercheuse principale), Alain Labelle, Jennifer Kutten, Carrie Robertson et Ali Manghi
Financement : 100 000 $ ; 2 ans
La clozapine est le traitement le plus efficace pour les personnes atteintes de schizophrénie réfractaire aux traitements, mais elle demeure sous-utilisée malgré ses bienfaits avérés pour contrôler les symptômes, prévenir le suicide et améliorer la qualité de vie. De récentes études internationales ont soulevé des préoccupations quant au fait qu’un usage prolongé de la clozapine pourrait accroître le risque de cancers du sang, notamment la leucémie et les lymphomes. Bien que ces risques semblent faibles, ils pourraient contribuer à décourager l’utilisation de la clozapine, d’où l’importance de vérifier si ces résultats s’appliquent au contexte canadien, où ce médicament fait l’objet d’une surveillance rigoureuse.
Cette étude se fondera sur les données des dossiers de santé et du Registre du cancer de l’Ontario pour comparer les taux de cancers du sang entre les personnes atteintes de schizophrénie prenant de la clozapine et celles prenant d’autres antipsychotiques. Les chercheurs examineront également si le risque de cancer varie selon la posologie, la durée du traitement ou des facteurs individuels comme l’âge et le sexe, et recueilleront les points de vue des patients et des familles au moyen de groupes de discussion. Les résultats fourniront des données claires sur l’innocuité de la clozapine au Canada, afin d’appuyer des décisions de traitement mieux éclairées et, éventuellement, d’améliorer la surveillance et l’accès à ce médicament essentiel.